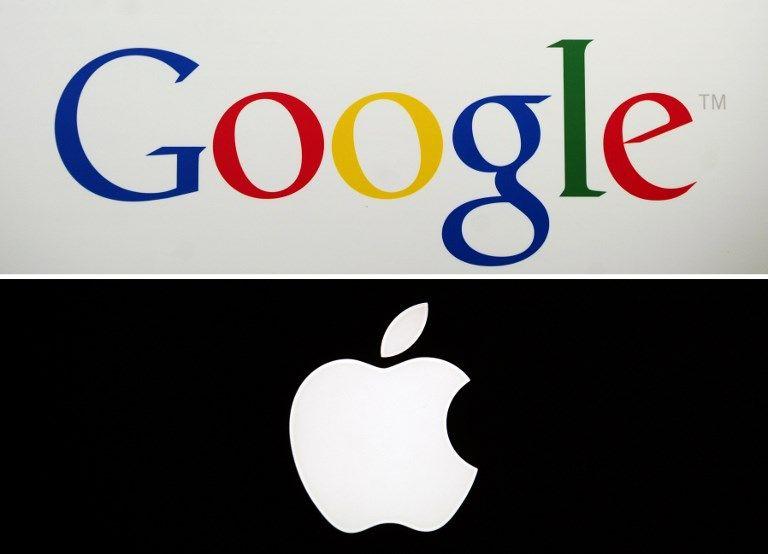
©
GROS SOUS
22 juillet 2018
Amende Google : pourquoi l’UE devrait aussi jeter un coup d’œil du côté d’Apple
Google a été frappé par une amende record de 4,3 milliards d’euros pour concurrence déloyale par la Commission Européenne.
0:00min
100%
100%
THEMATIQUES
Economie A PROPOS DES AUTEURS
Frédéric Marty est chercheur affilié au Département Innovation et concurrence de l'OFCE. Il également est membre du Groupe de Recherche en Droit, Economie et Gestion (GREDEG) de l'Université de Nice-Sophia Antipolis et du CNRS.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Frédéric Marty est chercheur affilié au Département Innovation et concurrence de l'OFCE. Il également est membre du Groupe de Recherche en Droit, Economie et Gestion (GREDEG) de l'Université de Nice-Sophia Antipolis et du CNRS.