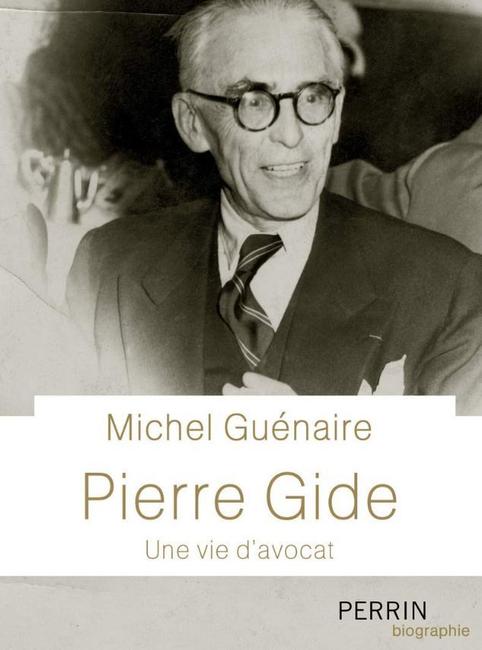
©
Pierre Gide éditions Perrin
BONNES FEUILLES
31 octobre 2020
Pierre Gide : le quotidien difficile d’un avocat sous l’Occupation
Michel Guénaire a publié "Pierre Gide, une vie d’avocat". En 1920, Pierre Gide, avocat aux barreaux de Paris et de Londres et cousin du Prix Nobel de littérature André Gide, ouvre son cabinet. En conseillant des entreprises, il invente le barreau d'affaires en France. Pionnier, il sera imité et jalousé, puis oublié, avant de renaître. Extrait 1/2.
MOTS-CLES
avocat , Justice , histoire , France , guerre , Occupation , résistance , Libération , biographieTHEMATIQUES
JusticeMichel Guénaire est avocat et écrivain. Il est l’auteur du Génie français (Grasset, 2006) et Après la mondialisation. Le retour à la nation (Les Presses de la Cité, 2022). Vous pouvez retrouver Michel Guénaire sur Twitter : @michelguenaire
Populaires
Michel Guénaire est avocat et écrivain. Il est l’auteur du Génie français (Grasset, 2006) et Après la mondialisation. Le retour à la nation (Les Presses de la Cité, 2022). Vous pouvez retrouver Michel Guénaire sur Twitter : @michelguenaire
